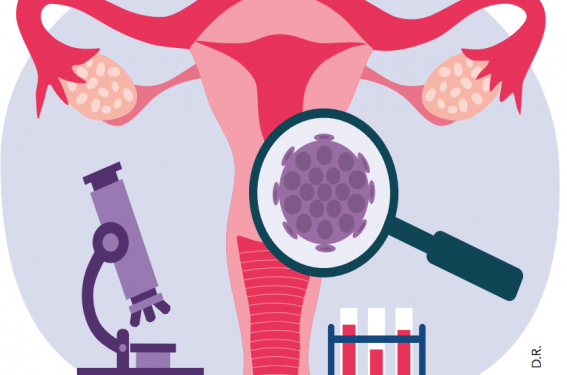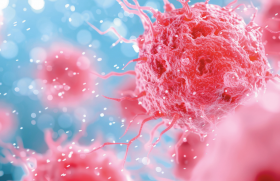Cancérologie
Publié le 20 déc 2024Lecture 5 min
Dépistage organisé du cancer du col utérin : les bons points et les sujets d’amélioration
Denise CARO, d’après la communication du Pr Jean Levêque (Rennes)
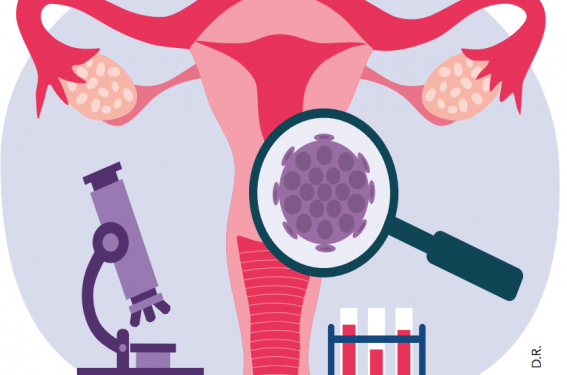
Le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus (CCU) mis en place par les pouvoirs publics en France vise à atteindre une couverture de 80 % afin de réduire la mortalité par CCU de 30 %(1). Il a également pour objectif d’améliorer l’accès au dépistage, en réduisant les mauvais et les surdépistages. Enfin, il entend améliorer la prise en charge des prélèvements positifs en diminuant les «perdus de vue», en limitant le surtraitement et en proposant des recommandations simplifiées et intelligibles par toutes et tous. En dépit de résultats positifs, des améliorations restent à faire.
Les bénéfices et les limites du dépistage organisé du CCU sont clairement identifiés. La cytologie en phase liquide (LBC), actuellement recommandée(2), permet de faire le test HPV et la cytologie en un seul et même prélèvement, avec une réalisation et une lecture plus faciles. Après 30 ans, le dépistage virologique est plus sensible que la cytologie : en cas de résultat négatif, le test HPV rassure pour les 5 ans à venir, alors qu’une cytologie normale ne le fait que pour les trois prochaines années(3,4). Toutefois, si depuis les années 1990 le dépistage organisé a permis une diminution du nombre de nouveaux cas de CCU en France, il doit encore être amélioré. En effet, la pente d’incidence et de mortalité ralentit. Et les femmes âgées les plus à risque sont celles qui bénéficient le moins de cette prise en charge. « L’une des principales améliorations à apporter est de mieux cibler les femmes à dépister », a indiqué le Pr Jean Levêque (CHU de Rennes).
Trop de dépistages chez les jeunes filles
On fait trop de dépistages chez les jeunes filles de moins de 25 ans (en dehors de quelques cas spécifiques ou localisations géographiques particulières). En effet, la mise en évidence et le suivi des quelques lésions de haut grade dans une population de jeunes filles âgées de 13 à 24 ans (par frottis, colposcopie et biopsie) montrent que la grande majorité des lésions régressent spontanément du fait de la clairance élevée des infections récentes chez les jeunes(5). « Il ne faut pas se précipiter chez ces jeunes femmes, a confirmé le Pr Levêque. Trop de co‐tests sont faits sans vrai bénéfice. » Le co‐test (cytologie + virologie) a un gain de sensibilité modeste et perte de spécificité par rapport à la virologie seule(6).
Pas assez chez les populations plus âgées
Si trop de dépistages sont effectués chez les jeunes, la population plus âgée n’est pas suffisamment dépistée et suivie. Actuellement, 60 % seulement des femmes sont dépistées, et ce chiffre baisse encore chez les femmes plus âgées. Or, c’est précisément dans cette population qu’il y a le plus de lésions précancéreuses ou cancéreuses. « Ce n’est pas satisfaisant, on a des efforts à faire pour toucher plus de patientes », a estimé le Pr Levêque. Trois ans après le début du dépistage organisé du CCU, le taux de couverture est de 65 % entre 25 et 45 ans et de 45 % entre 60 et 65 ans(1). L’accès à la prévention reste variable selon le niveau de diplôme ainsi que le niveau socio‐économique qui jouent sur la participation au dépistage. Or, ce sont précisément les femmes les moins favorisées qui ont le plus fort taux d’incidence de pathologies malignes et prémalignes.
Les pistes d’amélioration
« On change de paradigme avec l’apparition de la notion de réactivation », a indiqué le Pr Levêque. « Un test HPV négatif ne correspond pas obligatoirement à une absence totale de virus HPV ; la charge virale peut être trop faible pour être détectée par le test. » En effet, il est probable que l’on contracte un HPV dès les premiers rapports sexuels mais que la réaction immunitaire contrôle le développement du virus et maintienne durablement la charge virale en dessous du seuil de détection. Si, après plusieurs années, pour une raison ou une autre, l’immunité diminue, le virus se multiplie et peut provoquer des lésions. « La notion de réactivation de l’HPV explique que l’on détecte parfois une infection HPV chez une femme qui était négative et qui n’a plus de rapports sexuels depuis 10 ou 15 ans », a ajouté le Pr Levêque. Une étude américaine a montré que parmi les femmes qui étaient négatives et qui se sont positivées, 12, 4 % avaient un nouveau partenaire, 68,7 % avaient le même partenaire et 11,9 % n’avaient pas de rapports sexuels(7).
Par ailleurs, l’idée selon laquelle les lésions CIN2 ne relèvent pas d’une conisation mais d’une simple surveillance a été récemment remise en question dans une publication danoise qui a montré que les patientes avec une lésion CIN2 bénéficiant d’une surveillance développaient en 20 ans davantage de CCU que les femmes qui avaient eu une conisation(8). « On peut supposer que la conisation élimine le foyer où se cachait le virus », a estimé le Pr Levêque. Aussi toutes les femmes avec un passé de lésion HPV doivent‐elles être étroitement surveillées à très long terme (au‐delà de l’âge de 65 ans, âge auquel s’arrête le dépistage organisé). Selon l’INSEE, en 2023, l’espérance de vie des femmes de 65 ans était de 23 ans, ce qui laisse largement le temps à une lésion HPV de se transformer en CCU. Et en effet, même s’il est en diminution de CCU chez les plus de 65 ans existe encore bel et bien(9). « Nous disposons de bons outils de prévention du CCU avec le dépistage organisé et vaccin HPV ainsi que des recommandations claires, nous devons encore parvenir à les utiliser le mieux possible », a conclu le Pr Levêque.
D’après la communication du Pr Jean Levêque (Rennes), « Cancer du col utérin : bénéfices, limites et effets délétères du dépistage organisé par frottis cytologique ou test HPV HR ». Congrès Infogyn octobre 2024.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :